« Il détestait très profondément l’Amérique », écrivait John le Carré à propos de sa taupe soviétique fictive, Bill Haydon, dans Tinker Tailor Soldier Spy. Haydon venait d’être démasqué comme agent double au cœur des services secrets britanniques, un agent dont la trahison était motivée par une animosité, non pas tant envers l’Angleterre qu’envers l’Amérique. « C’est un jugement esthétique autant qu’autre chose », explique Haydon, avant d’ajouter précipitamment : « En partie un jugement moral, bien sûr. »
J’ai pensé à cela en regardant les scènes de protestation et de violence liées au meurtre de George Floyd se répandre à travers les États-Unis, puis ici en Europe et au-delà. Tout semblait si laid au début – si plein de haine, et de violence, et de préjugés bruts, non dilués contre les manifestants. La beauté de l’Amérique semblait avoir disparu, l’optimisme, le charme et la simplicité informelle qui attirent tant d’entre nous depuis l’étranger.
À un certain niveau, la laideur du moment semble une observation banale à faire. Et pourtant, elle est au cœur de la relation compliquée que le reste du monde entretient avec l’Amérique. Dans Tinker Tailor, Haydon tente d’abord de justifier sa trahison par une longue apologie politique, mais, en fin de compte, comme lui et le héros de Le Carré, le maître espion George Smiley, le savent tous deux, la politique n’est qu’une façade. La véritable motivation se trouve en dessous : l’esthétique, l’instinct. Haydon, issu de la classe supérieure, éduqué, cultivé, européen, ne pouvait tout simplement pas supporter la vue de l’Amérique. Pour Haydon et beaucoup d’autres comme lui dans le monde réel, cette répulsion viscérale s’est avérée si grande qu’elle les a rendus aveugles aux horreurs de l’Union soviétique, des horreurs qui allaient bien au-delà de l’esthétique.
La réflexion de Le Carré sur les motivations de l’anti-américanisme – liées, comme elles le sont, à ses propres sentiments ambivalents à l’égard des États-Unis – sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient en 1974, lorsque le roman a été publié pour la première fois. Là où il y avait Richard Nixon, il y a maintenant Donald Trump, une caricature de ce que les Haydons de ce monde méprisent déjà : effronté, cupide, riche et responsable. Dans le président et la première dame, les villes en feu et les divisions raciales, la brutalité policière et la pauvreté, une image de l’Amérique est projetée, confirmant les préjugés qu’une grande partie du monde a déjà – tout en servant également de dispositif utile pour masquer ses propres injustices, hypocrisies, racisme et laideur.
Plus d’histoires
Ta-Nehisi Coates : Le cas des réparations
Il est difficile d’échapper au sentiment que c’est un moment d’humiliation unique pour l’Amérique. En tant que citoyens du monde que les États-Unis ont créé, nous sommes habitués à écouter ceux qui détestent l’Amérique, admirent l’Amérique et craignent l’Amérique (parfois tous en même temps). Mais avoir pitié de l’Amérique ? C’est nouveau, même si la schadenfreude est douloureusement myope. Si c’est l’esthétique qui compte, les États-Unis d’aujourd’hui ne ressemblent tout simplement pas au pays que le reste d’entre nous devrait aspirer, envier ou reproduire.
Même dans les précédents moments de vulnérabilité américaine, Washington régnait en maître. Quel que soit le défi moral ou stratégique auquel il était confronté, on avait le sentiment que sa vivacité politique correspondait à sa puissance économique et militaire, que son système et sa culture démocratique étaient si profondément enracinés qu’il pouvait toujours se régénérer. C’était comme si l’idée même de l’Amérique comptait, comme un moteur qui la faisait avancer, quels que soient les autres problèmes qui existaient sous le capot. Aujourd’hui, quelque chose semble changer. L’Amérique semble embourbée, sa capacité à rebondir est remise en question. Une nouvelle puissance a émergé sur la scène mondiale pour défier la suprématie américaine – la Chine – avec une arme que l’Union soviétique n’a jamais possédée : la destruction économique mutuellement assurée.
La Chine, contrairement à l’Union soviétique, est capable d’offrir une mesure de richesse, de dynamisme et d’avancement technologique – bien que pas encore au même niveau que les États-Unis – tout en étant protégée par un rideau de soie d’incompréhension culturelle et linguistique occidentale. En revanche, si l’Amérique était une famille, ce serait le clan Kardashian, qui vivrait sa vie sous les feux de la rampe d’un public mondial attentif – ses allées et venues, ses défauts et ses contradictions étant visibles par tous. Aujourd’hui, vu de l’extérieur, on dirait que cette famille étrange, dysfonctionnelle, mais très prospère, souffre d’une sorte d’effondrement complet ; ce qui a fait la grandeur de cette famille n’est apparemment plus suffisant pour empêcher son déclin.
Les États-Unis – uniques parmi les nations – doivent subir l’agonie de cette lutte existentielle en compagnie du reste d’entre nous. Le drame de l’Amérique devient rapidement notre drame. En conduisant pour rejoindre un ami ici à Londres, alors que les manifestations ont commencé à éclater aux États-Unis, j’ai croisé un adolescent vêtu d’un maillot de basket avec le logo Jordan 23 dans le dos ; je l’ai remarqué parce que ma femme et moi avions regardé The Last Dance sur Netflix, un documentaire sur une équipe sportive américaine, sur une plateforme de streaming américaine. L’ami m’a dit qu’il avait repéré des graffitis en chemin : Je ne peux pas respirer. Dans les semaines qui ont suivi, des manifestants ont défilé à Londres, Berlin, Paris, Auckland et ailleurs pour soutenir Black Lives Matter, reflétant l’extraordinaire emprise culturelle que les États-Unis continuent d’avoir sur le reste du monde occidental.
Lors d’un rassemblement à Londres, le champion britannique des poids lourds Anthony Joshua a rappé les paroles de « Changes » de Tupac aux côtés d’autres manifestants. Les paroles, si choquantes, puissantes et américaines, sont pourtant si facilement traduisibles et apparemment universelles – même si la police britannique est en grande partie désarmée et qu’il y a très peu de fusillades policières. Depuis l’effusion initiale de soutien à Floyd, les projecteurs se sont tournés vers l’intérieur, ici en Europe. Une statue d’un ancien marchand d’esclaves a été démolie à Bristol, tandis qu’une statue de Winston Churchill a été vandalisée avec le mot « raciste » à Londres. En Belgique, des manifestants ont pris pour cible les monuments commémoratifs de Léopold II, le roi belge qui a fait du Congo sa propriété privée génocidaire. L’étincelle a peut-être été allumée en Amérique, mais les feux mondiaux sont entretenus par le carburant des griefs nationaux.
Pour les États-Unis, cette domination culturelle est à la fois une énorme force et une subtile faiblesse. Ils attirent des étrangers talentueux pour étudier, construire des entreprises et se rajeunir, modelant et entraînant le monde avec eux comme ils le font, influençant et déformant ceux qui ne peuvent échapper à leur attraction. Mais cette domination a un coût : Le monde peut voir en Amérique, mais l’Amérique ne peut pas regarder en arrière. Et aujourd’hui, la laideur qui s’affiche est amplifiée, et non apaisée, par le président américain.
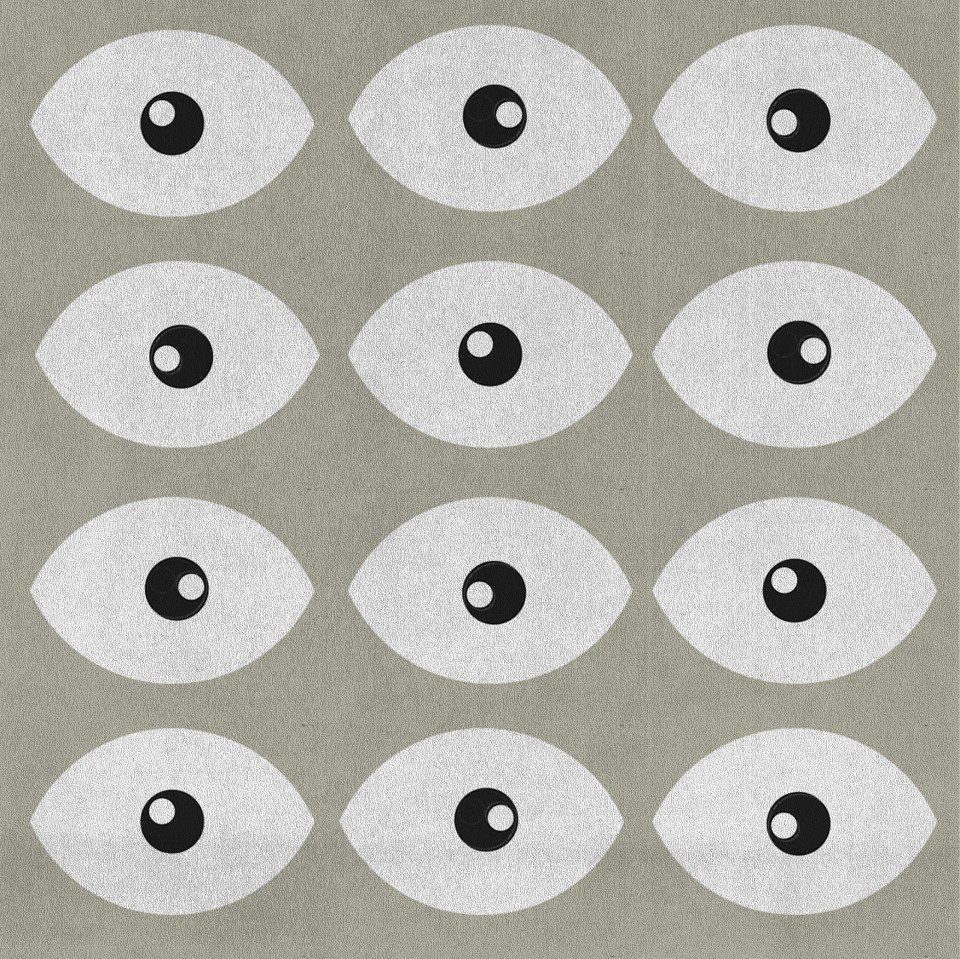
Pour comprendre comment ce moment de l’histoire américaine est perçu dans le reste du monde, j’ai parlé avec plus d’une douzaine de hauts diplomates, de responsables gouvernementaux, de politiciens et d’universitaires de cinq grands pays européens, y compris les conseillers de deux de ses dirigeants les plus puissants, ainsi que de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. De ces conversations, dont la plupart se sont déroulées sous le couvert de l’anonymat pour pouvoir s’exprimer librement, se dégage une image dans laquelle les alliés les plus proches de l’Amérique regardent avec une sorte d’incompréhension stupéfaite, incertains de ce qui va se passer, de ce que cela signifie et de ce qu’ils devraient faire, largement liés par l’angoisse et le sentiment partagé, comme me l’a dit un conseiller influent, que l’Amérique et l’Occident approchent d’une sorte de fin de siècle. « Le moment est propice », a dit ce conseiller. « Nous ne savons simplement pas avec quoi. »
Lire : Les répliques géopolitiques de la pandémie sont à venir
Les convulsions d’aujourd’hui ne sont pas sans précédent – beaucoup de ceux avec qui j’ai parlé ont cité les protestations et les émeutes précédentes, ou la diminution de la position de l’Amérique après la guerre d’Irak en 2003 (une guerre, pour être sûr, soutenue par la Grande-Bretagne et d’autres pays européens) – mais la confluence des événements récents et des forces modernes a rendu le défi actuel particulièrement dangereux. Les manifestations de rue, la violence et le racisme de ces dernières semaines ont éclaté au moment même où les défaillances institutionnelles du pays ont été mises à nu par la pandémie de COVID-19, renforcée par son fossé partisan apparemment infranchissable, qui infecte même maintenant des parties de la machine américaine qui n’ont pas été touchées jusqu’à présent : ses agences fédérales, son service diplomatique et les normes de longue date qui sous-tendent la relation entre les civils et les militaires. Tout cela se produit au cours de la dernière année du premier mandat du président le plus chaotique, le plus détesté et le moins respecté de l’histoire américaine moderne.
Bien sûr, tout cela ne peut pas être imputé à Trump ; en effet, certains de mes interlocuteurs ont dit qu’il était l’héritier et même le bénéficiaire de beaucoup de ces tendances, le yang cynique et amoral du premier yin post-Pax Americana de Barack Obama, qui était lui-même le résultat de la surenchère américaine en Irak après le 11 septembre. Blair et d’autres n’ont pas hésité non plus à souligner l’extraordinaire profondeur de la puissance américaine qui demeurait quelle que soit la personne à la Maison Blanche, ainsi que les problèmes structurels auxquels sont confrontés la Chine, l’Europe et d’autres rivaux géopolitiques.
La plupart de ceux avec qui j’ai parlé étaient, cependant, clairs sur le fait que le leadership de Trump a amené ces courants – en tandem avec la pression du déclin économique relatif, la montée de la Chine, la réémergence de la politique des grandes puissances, et le déclin de l’Occident en tant qu’union spirituelle – à une tête d’une manière et à une vitesse inimaginables auparavant.
Après presque quatre ans de présidence Trump, les diplomates, les fonctionnaires et les politiciens européens sont à des degrés divers choqués, consternés et effrayés. Ils ont été enfermés dans ce que l’un d’entre eux m’a décrit comme un « coma induit par Trump », incapables d’adoucir les instincts du président et avec peu de stratégie autre que de signaler leur aversion pour son leadership. Ils n’ont pas non plus été en mesure d’offrir une alternative à la puissance et au leadership américains, ni de répondre à certaines des plaintes fondamentales cohérentes à la fois pour Trump et son challenger démocrate pour la présidence, Joe Biden : le parasitisme européen, la menace stratégique de la Chine et la nécessité de s’attaquer à l’agression iranienne. Ce qui les a presque tous unis, c’est le sentiment que la place et le prestige de l’Amérique dans le monde sont maintenant directement attaqués par cette soudaine réunion de forces domestiques, épidémiologiques, économiques et politiques.
Lire : Pourquoi l’Amérique résiste à apprendre des autres pays
Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en Syrie qui a servi aux Nations unies pendant la guerre d’Irak, et qui travaille aujourd’hui comme conseiller spécial du think tank parisien Institut Montaigne, m’a dit que le nadir du prestige américain a été, jusqu’à présent, les révélations de torture et d’abus à l’intérieur de la prison d’Abu Ghraib près de Bagdad en 2004. « Aujourd’hui, c’est bien pire », a-t-il déclaré. Ce qui rend les choses différentes maintenant, selon Duclos, c’est l’ampleur de la division au sein des États-Unis et le manque de leadership à la Maison Blanche. « Nous vivons avec l’idée que les États-Unis ont une capacité de rebond quasi illimitée », a déclaré Duclos. « Pour la première fois, je commence à avoir des doutes. »
Alors que Tinker Tailor Soldier Spy arrive à sa conclusion, Smiley écoute patiemment les longues attaques décousues de Haydon sur l’immoralité et la cupidité de l’Occident. « En d’autres circonstances, Smiley aurait pu être d’accord avec une grande partie de ces propos », écrit Le Carré. C’est le ton, plutôt que la musique, qui l’a aliéné. »
Alors que le monde observe les États-Unis, est-ce le ton ou la musique qui provoque une réaction aussi viscérale ? Est-ce une chose esthétique, autrement dit, une réaction instinctive à tout ce que Trump représente, plutôt que le contenu de sa politique étrangère ou l’ampleur de l’injustice ? Si c’est le cas, pourquoi n’y a-t-il pas eu de marches en Europe contre l’incarcération massive des musulmans ouïgours en Chine, l’étouffement constant de la démocratie à Hong Kong et l’annexion de la Crimée par la Russie, ou contre des régimes meurtriers au Moyen-Orient, comme l’Iran, la Syrie ou l’Arabie saoudite ? N’est-il pas vrai, comme beaucoup de ceux avec qui j’ai parlé l’ont dit, que le meurtre de Floyd et la réponse de Trump sont devenus des métaphores de tout ce qui est mauvais et injuste dans le monde – pour la puissance américaine elle-même ?
Si cela est vrai, la révulsion contre les États-Unis est-elle simplement un autre accès de » politique comme art de la performance « , selon les mots d’un conseiller principal d’un dirigeant européen – un acte symbolique de défiance ? Sommes-nous témoins du fait que les possessions impériales de l’Amérique s’agenouillent métaphoriquement pour signaler leur opposition aux valeurs que l’empire en est venu à représenter ?
Le monde s’est, après tout, opposé à la musique de la politique américaine auparavant : sur le Vietnam et l’Irak, le commerce mondial et le changement climatique. Parfois, le ton et la musique se sont même conjugués pour aliéner les plus proches alliés de l’Amérique, comme sous George W. Bush, qui a été largement moqué, honni et opposé à l’étranger. Mais même cette opposition n’a jamais eu la même ampleur qu’aujourd’hui – rappelons que c’est une jeune Angela Merkel, alors dans l’opposition, qui a écrit une tribune pour le Washington Post en 2003 intitulée « Schroeder ne parle pas au nom de tous les Allemands », signalant le maintien de l’alliance de son parti avec les États-Unis, malgré l’opposition de l’Allemagne à la guerre en Irak. Pour parler franchement, Trump est unique. Au niveau le plus élémentaire, Bush n’a jamais reculé devant l’idée fondamentale qu’il existait un chant occidental, et que les paroles devaient être composées à Washington. Trump aujourd’hui n’entend aucune musique unificatrice – seulement le rythme sourd de l’intérêt personnel.
Un conseiller principal d’un dirigeant européen, qui n’a pas voulu être nommé concernant des délibérations privées, m’a dit que le snobisme continental à l’égard de la notion de leadership américain du monde libre, du « rêve américain » et d’autres clichés rejetés jusqu’à présent comme désespérément naïfs, a soudainement été exposé par le cynisme de Trump. Ce n’est qu’une fois que la naïveté a été enlevée, a dit le conseiller, que l’on peut voir qu’elle a été « une force plus puissante et organisatrice que la plupart… ne le réalisent. » La pourriture, dans cette lecture, a commencé avec Obama, un cynique professoral de l’Occident, et a culminé avec Trump, dont l’abandon de l’idée américaine marque une rupture dans l’histoire du monde. Pourtant, si l’Amérique ne croit plus en sa supériorité morale, que reste-t-il sinon l’équivalence morale ?
C’est comme si Trump confirmait certaines des accusations portées contre l’Amérique par ses plus fervents détracteurs – même lorsque ces affirmations ne sont pas vraies. L’historien britannique Andrew Roberts et d’autres ont noté, par exemple, qu’un filon d’anti-américanisme traverse les romans de Le Carré, trouvant son expression dans une équivalence morale qui ne résiste pas à l’examen. Dans Tinker Tailor, le Carré ramène le lecteur à un moment du passé où Smiley tente de recruter le futur chef des services secrets russes. « Écoutez », dit Smiley au Russe, « nous devenons de vieux hommes, et nous avons passé notre vie à chercher les faiblesses de nos systèmes respectifs. Je peux voir à travers les valeurs orientales tout comme vous pouvez voir à travers nos valeurs occidentales… Ne pensez-vous pas qu’il est temps de reconnaître qu’il y a aussi peu de valeur de votre côté que du mien ? »
Anne Applebaum : La fausse romance de la Russie
Comme l’a montré ma collègue Anne Applebaum, l’Union soviétique a supervisé la famine, la terreur et le meurtre de masse de millions de personnes. Quels que soient les récents défauts de l’Amérique, ils ont été pratiquement et moralement incomparables à ces horreurs. Aujourd’hui, alors que Pékin supervise la surveillance massive de ses citoyens et incarcère un groupe ethnique minoritaire presque en masse, on peut dire la même chose de la Chine. Et pourtant, cette affirmation d’équivalence morale n’est plus la calomnie d’un cynique étranger, mais l’opinion du président des États-Unis lui-même. Dans une interview avec Bill O’Reilly sur Fox News en 2017, on a demandé à Trump d’expliquer son respect pour Poutine, et il a répondu avec les généralités habituelles sur le président russe qui dirige son pays et sa lutte contre le terrorisme islamiste, ce qui a incité O’Reilly à interjeter : « Poutine est un tueur ». Trump a alors répondu : « Il y a beaucoup de tueurs. Nous avons beaucoup de tueurs. Quoi, vous pensez que notre pays est si innocent ? » (Avant de devenir président, Trump a également fait l’éloge de la force apparente de la Chine, qui a violemment réprimé les manifestations pro-démocratiques de la place Tiananmen.)
Un tel cynisme – à savoir que toutes les sociétés sont aussi corrompues et intéressées les unes que les autres – avait auparavant été entièrement rejeté par les États-Unis. Aujourd’hui, les relations internationales ne sont guère plus qu’un marchandage transactionnel pour les États-Unis, et le pouvoir – et non les idéaux, l’histoire ou les alliances – est la monnaie.
L’ironie est que cet ordre mondial mondialisé moralement équivalent, dépouillé des notions naïves du « monde libre » des États-nations démocratiques, trouve son image miroir dans les manifestations de rue internationalisées et post-nationales contre le racisme auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines. Les manifestants ont défilé en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont toutes deux leurs propres divisions raciales et leur propre histoire d’abus, ainsi qu’en Grande-Bretagne et en France, qui ont toutes deux une histoire de colonialisme et des divisions persistantes entre races et classes. Il est remarquable, comme l’a souligné Ishaan Tharoor du Washington Post, qu’il ait fallu la mort d’un homme noir à Minneapolis pour que les autorités belges retirent une statue de la personne responsable de certains des crimes coloniaux les plus odieux de l’histoire.
Pour l’Europe, en particulier, la domination continue des États-Unis – culturellement, économiquement et militairement – reste sa réalité fondamentale. Certains de mes interlocuteurs ont déclaré que ce n’étaient pas seulement les manifestants qui étaient coupables d’une forme d’aveuglement sélectif, mais les dirigeants européens eux-mêmes qui cherchaient la protection de l’Amérique, tout en refusant de se plier à toute préoccupation démocratiquement exprimée qui allait au-delà de Trump. « Il y a eu trop de gestion et pas assez de mouvement », m’a dit un conseiller d’un dirigeant européen. À l’heure actuelle, l’étendue de la stratégie de l’Europe semble être de simplement attendre Trump et d’espérer que la vie puisse revenir à l’ancien ordre international « fondé sur des règles » après qu’il ait quitté ses fonctions. À Londres et à Paris, cependant, on reconnaît de plus en plus que cela ne peut pas être le cas – qu’il y a eu un changement fondamental et permanent.
Les personnes avec qui j’ai parlé ont divisé leurs préoccupations, implicitement ou explicitement, entre celles causées par Trump et celles exacerbées par lui – entre les problèmes spécifiques de sa présidence qui, selon eux, peuvent être rectifiés, et ceux qui sont structurels et beaucoup plus difficiles à résoudre. Presque toutes les personnes avec lesquelles j’ai parlé s’accordent à dire que la présidence de Trump a été un tournant, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier : C’est quelque chose qui ne peut être défait. Les mots une fois dits ne peuvent pas être défaits ; les images qui sont vues ne peuvent pas ne pas être vues.
La préoccupation immédiate pour beaucoup de ceux que j’ai interrogés était l’apparent creusement de la capacité américaine. Lawrence Freedman, professeur d’études de guerre au King’s College de Londres, m’a dit que les institutions du pouvoir américain elles-mêmes ont été « malmenées ». Le système de santé est en difficulté, les municipalités sont financièrement ruinées et, au-delà de la police et de l’armée, peu d’attention est accordée à la santé de l’État lui-même. Le pire, dit-il, c’est qu' »ils ne savent pas comment le réparer ».
Les divisions internes sont telles, en fait, que de nombreux observateurs étrangers s’inquiètent maintenant que ces divisions affectent la capacité de Washington à protéger et à projeter sa puissance à l’étranger. « Y aura-t-il un jour où ces problèmes sociétaux affecteront la capacité du pays à rebondir et à relever les défis internationaux auxquels il est confronté ? ». a déclaré Duclos. « C’est désormais une question qu’il est légitime de se poser. »
Prenez la confusion autour du prochain sommet du G7 en septembre. Trump a cherché à élargir le groupe, en incluant notamment la Russie et l’Inde, dans le but, m’a-t-on dit, de construire un concert de puissances anti-Chine. Mais cette idée a été rejetée par la Grande-Bretagne et le Canada, et Mme Merkel a refusé de se présenter en personne pendant la pandémie. (En coulisses, la France a essayé de se raccommoder – ce n’est pas ainsi qu’une superpuissance est censée être traitée). « Cela allait être du spectacle, et les gens ne veulent tout simplement pas être associés à lui », m’a dit Freedman.
Lire : Comment en sommes-nous arrivés là ?
Les États-Unis ont cependant déjà été dans cette situation et ont montré leur capacité à rebondir, de la Grande Dépression au Vietnam en passant par le Watergate. À ces moments-là, cependant, des hommes de stature ont occupé la Maison Blanche – faillis, parfois corrompus, parfois même criminels, mais tous sûrs du rôle unique de l’Amérique dans le monde.
Un ambassadeur européen m’a dit que Trump lui-même est une expression du déclin américain. « Choisir Trump est une manière de ne pas réussir à s’adapter au monde globalisé », a déclaré le diplomate, qui a requis l’anonymat. C’est le signe que les États-Unis suivent les autres grandes puissances vers le bas, ce que Biden – un septuagénaire qui doit être protégé des foules parce qu’il fait partie des populations les plus vulnérables au nouveau coronavirus – ne fait qu’illustrer davantage. « Cela montre qu’il y a un élément permanent dans les nouveaux États-Unis qui n’est pas très sain », a déclaré cet ambassadeur.
Duclos est d’accord : « Les Pays-Bas étaient la puissance mondiale dominante au 18e siècle. Aujourd’hui, ils sont un pays prospère, mais ils ont tout simplement perdu leur pouvoir. Dans une certaine mesure, le Royaume-Uni et la France sont en passe de devenir les Pays-Bas, et les États-Unis sont en passe de devenir la Grande-Bretagne et la France. » Bruno Maceas, ancien ministre de l’Europe du Portugal, dont le livre The Dawn of Eurasia se penche sur la montée en puissance de la Chine, m’a dit : « L’effondrement de l’empire américain est un fait acquis ; nous essayons juste de comprendre ce qui le remplacera. »
Tout le monde n’est pas convaincu. Blair, par exemple, m’a dit qu’il était sceptique à l’égard de toute analyse suggérant que le temps où l’Amérique était la puissance prééminente du monde touchait à sa fin. « Vous devez toujours faire la distinction dans les relations internationales entre ce que les gens pensent du style personnel du président Trump et ce qu’ils pensent de la substance de la politique », a-t-il dit – l’esthétique et la réalité sous-jacente, en d’autres termes.
Blair a offert trois « mises en garde très importantes » à l’idée du déclin américain. Premièrement, a-t-il dit, le soutien à la substance de la politique étrangère de Trump est plus important qu’il n’y paraît. Il a cité la nécessité pour l’Europe d’augmenter ses dépenses de défense, la volonté des Américains de mettre sur la table les pratiques commerciales de la Chine et le recul de Trump contre l’Iran au Moyen-Orient. Deuxièmement, M. Blair a fait valoir que les États-Unis restent extraordinairement résilients, quels que soient leurs défis actuels, en raison de la force de leur économie et de leur système politique. Une dernière mise en garde, selon l’ancien dirigeant britannique, est la Chine elle-même, dont l’omnipotence mondiale ou le respect ne doit pas être surestimé.
Blair-un américanophile convaincu-a néanmoins souligné que les forces structurelles à long terme des États-Unis ne minimisent pas leurs défis immédiats. « Je pense qu’il est juste de dire que beaucoup de dirigeants politiques en Europe sont consternés par ce qu’ils considèrent comme l’isolationnisme croissant en Amérique et l’indifférence apparente aux alliances », a-t-il déclaré. « Mais je pense qu’il y aura un moment où l’Amérique décidera, dans son propre intérêt, de se réengager, donc je suis optimiste sur le fait que l’Amérique finira par comprendre qu’il ne s’agit pas de reléguer son intérêt personnel derrière l’intérêt commun ; c’est une compréhension qu’en agissant collectivement en alliance avec d’autres, on promeut ses propres intérêts ».
« Je ne diminue pas la situation en ce moment », a-t-il poursuivi, « mais vous devez faire vraiment attention à ne pas ignorer les choses profondes et structurelles qui maintiennent cette puissance américaine. »
En fin de compte, même dans ce moment d’introspection et de division américaine, alors qu’elle se retire de son rôle de seule superpuissance mondiale, pour la plupart des pays dans son orbite, il n’y a pas d’alternative réaliste à son leadership. Lorsque Trump a retiré les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, les trois grandes nations européennes – la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – ont tenté de le maintenir en vie elles-mêmes, sans grand succès. La puissance financière et militaire américaine signifiait que même leur puissance combinée n’était pas pertinente. En Libye, sous Obama, la Grande-Bretagne et la France ne pouvaient intervenir qu’avec l’aide des Américains. Comme des adolescents qui crient à la fois pour qu’on les laisse tranquilles et pour que leurs parents les déposent au club, les alliés occidentaux de l’Amérique veulent tout avoir.
Lire : Comment la Chine prévoit de reconquérir le monde
La vérité est que nous vivons dans un monde américain, et que nous continuerons à le faire, même si sa puissance s’estompe lentement. À un certain niveau, l’Europe qui a envoyé des dizaines de milliers de personnes écouter Obama parler à la porte de Brandebourg alors qu’il n’était même pas encore président est la même qui s’est entassée par dizaines de milliers dans les capitales européennes au plus fort d’une pandémie mondiale pour demander justice pour George Floyd : C’est une communauté internationale obsédée par l’Amérique, et dominée par elle. C’est une communauté qui a l’impression d’avoir un intérêt dans l’Amérique, parce que c’est le cas, même si elle n’en fait pas constitutionnellement partie.
Si c’est un moment d’humiliation unique pour les États-Unis, alors, c’est aussi, par définition, un moment d’humiliation unique pour l’Europe. Chacun des grands pays du continent a la liberté de rompre avec le pouvoir américain s’il en a la volonté politique, mais préfère offrir une opposition symbolique tout en espérant un changement de leadership. À certains égards, la réponse de l’Europe depuis 2016 a été presque aussi lamentable que Trump l’a été pour le prestige américain.
En 1946, lorsque Winston Churchill est arrivé à Fulton, dans le Missouri, pour prononcer son célèbre discours sur le rideau de fer, la puissance des États-Unis était évidente. Les États-Unis avaient les armes pour détruire le monde, la portée militaire pour le contrôler et l’économie pour continuer à s’enrichir grâce à lui. Churchill commence son discours par un avertissement : « Les États-Unis se trouvent en ce moment au sommet de la puissance mondiale. C’est un moment solennel pour la démocratie américaine. Car la primauté du pouvoir s’accompagne également d’une responsabilité impressionnante vis-à-vis de l’avenir. Si vous regardez autour de vous, vous devez ressentir non seulement le sentiment du devoir accompli, mais aussi l’angoisse de tomber en dessous du niveau des réalisations. »
Le problème de l’Amérique est que le reste du monde peut voir quand elle est tombée en dessous de ses réalisations. Dans des moments comme celui que nous vivons actuellement, il est difficile de contester certaines des critiques formulées par les détracteurs les plus virulents du pays à l’étranger : qu’il est irrémédiablement raciste ou trop ambivalent face à la pauvreté et à la violence, aux brutalités policières et aux armes à feu. Les droits et les torts ne semblent pas particulièrement compliqués dans ce dilemme, même si le pays lui-même l’est.
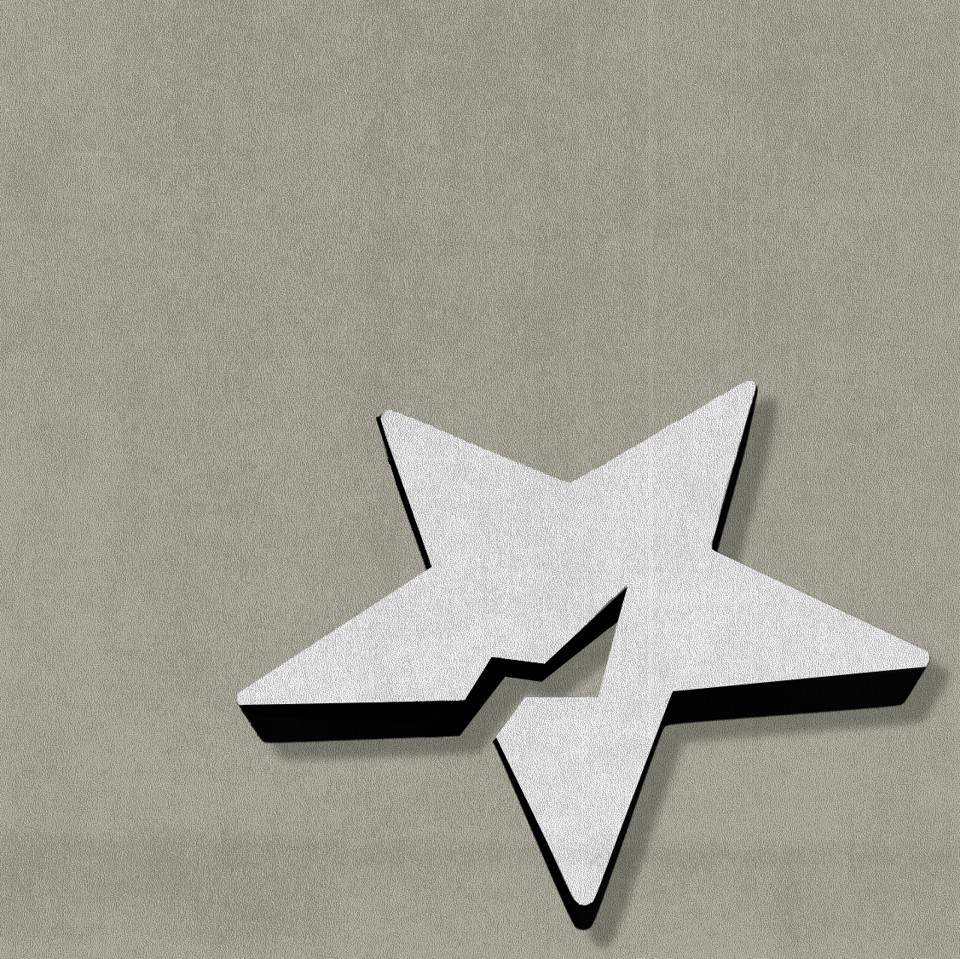
Cependant, c’est aussi une nation qui n’est pas la Russie ou la Chine, autant que son propre dirigeant voudrait nous le faire croire. À Moscou et à Pékin, pour commencer, il ne serait pas possible de protester en si grand nombre et avec une telle véhémence. D’un point de vue européen, il est également frappant de voir l’énergie, l’éloquence et l’autorité morale qui émergent à nouveau de la base – la beauté de l’Amérique, pas sa laideur. Écouter un rappeur d’Atlanta s’exprimer lors d’une conférence de presse, ou un chef de police de Houston s’adresser à une foule de manifestants, c’est voir un orateur public plus accompli, plus puissant et plus éloquent que presque tous les politiciens européens auxquels je peux penser. Ce qui est différent aujourd’hui, c’est que l’on ne peut pas en dire autant du président ou du candidat démocrate qui veut le remplacer.
En outre, autant il y a un racisme évident en Amérique, autant il reste des préjugés subtils, profonds et omniprésents en Europe, ce qui signifie que ses échecs peuvent être moins évidents mais ne sont pas moins répandus. Où, pourrait-on se demander, les chances de réussite et d’avancement des Noirs et des minorités ethniques sont-elles les plus grandes, en Europe ou en Amérique ? Un rapide coup d’œil à la composition du Parlement européen – ou de presque n’importe quel média, cabinet d’avocats ou conseil d’administration européen – donne à réfléchir à quiconque est enclin à croire que c’est la première option. Comme me l’a dit un ami vivant aux États-Unis, il y a encore une sacrée quantité de colle qui maintient les États-Unis ensemble, avec ou sans Trump.
Anne Applebaum : L’histoire jugera les complices
Au cours de son histoire, l’Amérique a connu un certain nombre de crises – et un certain nombre de détracteurs. Le Carré n’est qu’un des nombreux auteurs à s’être plongé dans le puits d’émotions contradictoires que les États-Unis parviennent à susciter chez ceux qui les regardent de l’extérieur, en partie horrifiés, en partie obsédés. Dans son livre de voyage, American Notes, par exemple, Charles Dickens évoque son dégoût pour une grande partie de ce qu’il a vu lors de ses aventures à travers le pays. « Plus Dickens côtoyait les Américains, plus il se rendait compte que les Américains n’étaient tout simplement pas assez anglais », a expliqué Jérôme Meckier, professeur et auteur de Dickens : An Innocent Abroad, a déclaré à la BBC en 2012. « Il a commencé à les trouver autoritaires, vantards, vulgaires, incivils, insensibles et surtout cupides. » En d’autres termes, c’est à nouveau l’esthétique. Dans une lettre, Dickens a résumé ses sentiments : « Je suis déçu. Ce n’est pas la république de mon imagination. »
Dickens, comme le Carré, a saisi l’emprise unique de l’Amérique sur le monde et la réalité fondamentale qu’elle ne pourra jamais être à la hauteur de l’imagination des gens sur ce qu’elle est, bonne ou mauvaise. En regardant aujourd’hui, le monde recule mais ne peut s’empêcher de regarder. Aux États-Unis, le monde se voit, mais sous une forme extrême : plus violent et plus libre, plus riche et plus réprimé, plus beau et plus laid. Comme Dickens, le monde attend davantage de l’Amérique. Mais comme le Carré l’a observé, c’est aussi, en grande partie, une question d’esthétique – nous n’aimons pas ce que nous voyons quand nous regardons bien, parce que nous nous voyons nous-mêmes.